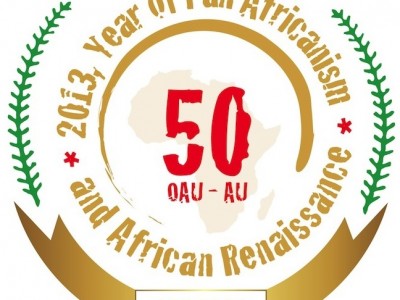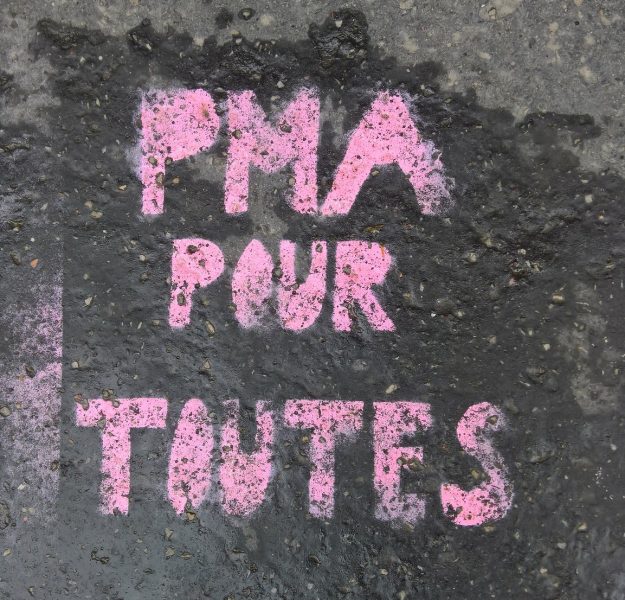
Image d'un graffiti parisien datant de 2018, plaidant pour l'accès universel à la PMA (procréation médicalement assistée). Photo d’Ittmostt sur Flickr (CC BY 2.0)
L’article original a été publié en anglais le 09 mars 2021.
[Sauf mention contraire, tous les liens renvoient vers des pages en français, ndlt.]
Bien que la société française ait progressivement accepté les familles non conformes à la norme hétérosexuelle cisgenre « traditionnelle », qui existent depuis plusieurs décennies, les protections légales associées à l'accès à la procréation médicalement assistée et à la reconnaissance parentale demeurent lacunaires. Des inégalités persistent pour les individus aspirant à fonder une famille, car la loi ne garantit toujours pas une protection juridique suffisante en matière d'accès à la procréation médicalement assistée et à la reconnaissance parentale.
Le président français Emmanuel Macron fait actuellement pression pour que le projet de loi, destiné à légaliser l'accès à la FIV et à l'insémination artificielle pour les femmes célibataires et les couples de femmes, soit adopté « d’ici à l’été 2021 », conformément à sa promesse de campagne de 2017. Cette réforme clé a été récemment rejetée par le Sénat, provoquant la déception parmi les nombreux·ses militant·e·s impliqué·e·s dans cette longue bataille juridique. Certains espèrent néanmoins que le projet de loi sera adopté par l’Assemblée nationale.
La complexité de cette question va bien au-delà d'un simple débat entre un État homogène et des courants progressistes.
Une certitude émerge : selon l'exécutif français, les chances d'accéder à la parentalité ne sont pas les mêmes pour toutes et tous. Les femmes célibataires sont curieusement qualifiées de « vulnérables » par certain·e·s député·e·s, tandis que les personnes transgenres font face à un manque de considération tel qu'elles sont à peine mentionnées dans le plan national de lutte contre les discriminations LGBT+. Tout porte à croire qu’en France, le désir de procréation de certaines catégories de personnes soit jugé illégitime et anormal, contraignant de nombreuses femmes célibataires et personnes LGBTQI+ à chercher des alternatives à l'étranger en attendant que leur pays leur assure un accès à la procréation médicalement assistée (PMA).
La controverse suscitée par La Manif Pour Tous, opposée au projet de loi, repose en partie sur l'idée que les couples lesbiens ou les femmes célibataires, en ayant un enfant sans père, les priveraient de leurs « véritables origines ». Toutefois, la question de l'équilibre psychologique de l'enfant pourrait être résolue en adoptant la proposition de loi sur les dons semi-anonymes, qui permettrait l'accès à des informations sur le donneur sous certaines conditions, plutôt que de restreindre l'accès à la PMA.
Le fond du problème semble surtout reposer sur la crainte que les hommes pourraient perdre leur statut dans la société. Les opposant·e·s au projet de loi soutiennent que permettre aux femmes d'accéder à la procréation sans la présence directe d'un homme, hormis le donneur de sperme, équivaudrait à accepter l'idée qu'ils deviennent des « pères à usage unique ». Cette perspective semble intrinsèquement menacer une société structurée selon une division binaire des genres.
La question de la charge mentale déjà présente chez les femmes en matière de procréation et d'éducation des enfants est délibérément négligée par les partisans de La Manif Pour Tous. Le médecin français Baptiste Beaulieu a souligné dans un tweet que les femmes s'occupent souvent davantage des enfants, mais qu’« à la simple évocation de la PMA pour toutes, de nombreux hommes défendent vigoureusement leur droit à la paternité, un rôle qu'ils délèguent pourtant fréquemment dans la vie réelle ». Il serait alors légitime de se demander avec une pointe d'impertinence si les couples hétérosexuels sont aptes à avoir des enfants, mais c'est une question qui ne relève pas de notre compétence, c'est d'ailleurs tout notre propos.
Une étude récente sur les procédures d'adoption en France révèle le portrait type du « bon candidat », favorisant un couple stable financièrement, menant une vie « équilibrée », de préférence hétérosexuel, blanc et non handicapé. Les instances chargées de l'application de la loi, impactent directement la sphère intime des individus, en revanche les assistant·e·s sociaux·ales orientent leurs décisions en fonction de ce qui est considéré comme « le meilleur choix possible » pour l’enfant.
Il est légitime de se demander ce que signifie le terme « bonne famille » et comment le gouvernement français, majoritairement composé d’élu·e·s non concerné·e·s par ces problématiques, définit le concept de famille.
Comment définir le concept de « famille » ?
La législation française, marquée par un certain conservatisme, maintient le principe de primauté biologique. La législation prévoit clairement que seuls les deux individus ayant fourni le matériel génétique essentiel à la conception de l'enfant, à savoir la mère biologique et l'homme marié avec elle ou reconnu comme le père en mairie, sont légalement considérés comme les parents. Actuellement, toutes les autres situations, telles que la coparentalité [en], les familles recomposées [en] ou les parents LGBTQ+, requièrent une manoeuvre juridique, impliquant généralement une procédure d'adoption.
Cela signifie, par exemple, que lorsque trois ou quatre personnes décident de s’engager dans la voie de la coparentalité, seules deux d'entre elles obtiendront la reconnaissance légale en tant que parents, les autres étant complètement écartées de la sphère familiale jusqu'à la finalisation des procédures d'adoption. Les couples de femmes rencontrent une problématique similaire, car seule la mère biologique peut être inscrite sur l'acte de naissance. En cas de séparation avant l'achèvement du processus d'adoption, l'un des parents risque d'être entièrement exclu de la vie de l'enfant.
Avec l'émergence de familles considérées comme « atypiques », de plus en plus visibles et dont la voix se fait désormais entendre, la définition du concept de famille évolue. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans la société, mais que les magistrats et le législateur ont la capacité de restreindre en définissant les contours d'une parentalité jugée « légitime ». C'est un enjeu majeur, qui dépasse le cadre strictement juridique. Même en cas d'adoption du projet de loi actuellement en discussion au sein du gouvernement, il restera beaucoup à faire pour que la diversité des familles françaises soit pleinement reconnue.
Le chemin à parcourir pour normaliser la parentalité en dehors du cadre strict défini par la loi est encore long. Dès lors que la parentalité devient difficilement envisageable sans assistance médicale ou du moins sans l’intervention d’un donneur, chacun·e, du religieux au politique, tente de prendre part au débat. Les obstacles, qu'ils soient d'ordre matériel ou mental, liés à ces questions, peuvent malheureusement entraver la réalisation des projets de certains futurs parents. Celles et ceux qui, motivés par leur désir de devenir parents, choisissent de se confronter à ces procédures administratives laborieuses, le font en toute connaissance de cause et en ayant conscience parfois de contourner la loi.
Il semble difficile d’anticiper la direction que prendra le Parlement à ce sujet, mais il est certain que les militant·e·s, dans un camps comme dans l'autre, poursuivront leur engagement.